Film dramatique américain réalisé par Paul Thomas Anderson et sortit en 2013. 2H20

Film dramatique américain réalisé par Paul Thomas Anderson et sortit en 2013. 2H20


Thriller dramatique américain réalisé par Nicolas Winding Refn est sortit en 2011.

Des yeux bleu acier fixent, sur un balcon, une ville endormie. Ses gratte-ciels carrés où des lumières jaillissent encore. Ses voitures de toutes couleurs roulant, en bas, sur les routes. Il a une veste d'un gris flashy. Un scorpion jaune se baladant sur le dos. Une voix monocorde, agaçante, qui se déroule sans nuance. Un visage obscur filmé dans d'improbables angles. Il cause peu, voir jamais. Pour ne pas parler pour ne rien dire. Ou pour ne pas en dire trop. On ne sait pas d'où il vient. Nul ne sait qui il est. Il ne se bat pas. Ne tue pas... Il conduit. Il a un téléphone entre les doigts. Et des mains un peu sales, mais pas encore trop crasseuses. Ses battements de coeur, pulsations discrètes, se font entendre. Et deviennent, soudain, musique, morceau étrange, entraînant. Plan suivant : un moteur hurle. Une voiture roule, doucement. A l'arrière, deux types masqués regardent dehors, inquiets. Le conducteur, devant, est étrangement serein, calme. Il a les mains posées sur le volant. Des yeux bleus acier fixant, cette fois, le par brise. Ecoutant tranquillement, à la radio, un match de basket. Puis, la voiture accélère. Dehors, il fait encore nuit. Le match continue. La voiture roule plus vite. Le match se poursuit. La voiture roule à fond, sème ses poursuivants, le moteur hurlant plus fort....Et le match se termine, délivrant des cris de joie. Des acclamations. Des bruits quelconques. Là, le générique démarre, des fines lettres rose bonbon s'inscrivent - pour contraster avec la virilité du héros -, éclairant la pénombre. Et se noient aux lumières claires qui persistent encore. Et ce, toute la nuit. Soleil sous l'horizon, obscurité inquiétante, lueurs vacillante : Los Angeles dort. Et c'est beau. Désespérément. Refn sait filmer la ville. La sienne est touffue, truffée de personnages abjects, luxuriante comme la jungle, hanté comme un vieux et grand cimetière. Il la peuple de mafieux ignobles, d'un héros au regard de fer, vide. Il conte des histoires inintéressantes et vaines, mais leur accorde toute l'immense beauté de l'art. Son oeuvre est un véritable film fantôme, désincarné dans le plus beau sens du terme, lisse et sans fond, à l'image effrayante des personnages : plus des hommes, mais de véritables spectres froids gangrenés de l'intérieur, qui se feront tomber les uns les autres. Drive est d'une beauté qui sidère, d'une noirceur concentrée, d'une violence menaçante qui n'explose que rarement, laissant naître en son absence des moments de contemplation superbes, où tout se joue dans les images, dans les silences, les visages qui se ferment, les hommes qui tombent, la mort qui danse. Plaçant l'action de son film dans un monde entièrement clos sur lui-même, comme si derrière la caméra, il n'y aurait plus rien, Refn à l'intelligence de laisser travailler l'imagination du spectateur : son héros, d'où vient t-il ? Que veut-il ? Refn s'en moque un peu. Son nom ? Ses intentions ? Son avis sur ce qu'il lui arrive, alors ? La belle affaire...L'important, c'est le corps, ce qu'il endure, ce qu'il reçoit, ce qu'il rejette. Drive sonne comme la musique du vacillement des corps, et c'est magnifique. Si le scénario n'a rien de spécial, la mise en scène possède une force sûre. Une originalité qui fait indéniablement passer Refn du côté des grands. Son oeuvre est un plaisir de cinéma aux protagonistes désincarnés, comme fut ceux du sublime Barry Lyndon d'un certain Kubrick, stylisé et fermé sur le monde, puisque possédant son propre univers. Semblant soudain très court, le film semble toujours fuir comme le temps : à toute vitesse. Rapide, brut, même dans ces plus calmes moments de contemplation, et ce jusqu'à la dernière, toute dernière seconde. Drive - et c'est cela qui lui accorde, sans doute, sa flagrante beauté artistique - est un étonnant rêve éphémère.
Mise en scène : 5/5
Interprétation : 4/5
Travail artisitque : 5/5
Scénario : 2/5
Total des points : 16/20
Retour à l'index <----
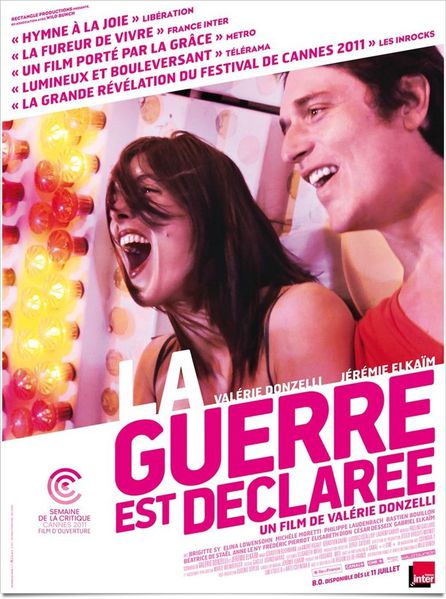
Comédie dramatique française réalisée par Valérie Donzelli et sortit en 2011. 1H35.

Noir. Le "rideau" se lève peu à peu. Dans le cadre, des jambes se pressent. Des pas résonnent contre un sol blanc. Lisse. Enfin, le titre paraît, écrit en grosses lettres rouges, accompagné d'un majestueux son : déjà, la guerre est déclarée, solennellement, en plus. Au fur et a mesure, des gommettes pailletées apparaissent sur l'écran, des lumières mauves sucettes illuminent les personnages, des sons étranges noient les images : c'est la couleur de la vie, du moins celle qu'elle devrait prendre, chaque jour, quoi qu'il en coûte. Il s'appelle Roméo. Elle s'appelle Juliette. A eux deux, ils sont l'amour, la passion. Les protagonistes ne sont pas des personnages : ce sont des images, des représentations, sensées incarner naïvement tour à tour l'amour, la colère, la joie, la tristesse. Le film à un côté amateur, dans son interprétation surtout et ses effets un peu désuets de la mise en scène (Voix off chiante, zoom sur le téléphone...) La forme, parfois à revoir, donc, semble écrasée par le fond, qui lui charme, littéralement. L'histoire émeut, mais d'une autre manière, cette fois. Pas de pathos, pas de plans fixes noyés dans les larmes, justes des images, des souvenirs, fulgurants, explosant à chaque plan. Le film semble tout le temps être une fleur rose qui éclot soudainement, une cerise rouge vif que l'on aime déguster, sucrée comme il le faut. Donzelli se permet tout : ellipses narratives, accélérations abruptes ou dilatation du temps, essaye différent morceaux de musique comme une ribambelle de nouvelles robes. Elle offre à son histoire terrible toute la valeur du cinéma, qui semble respirer à chaque seconde, nourri par des effets stylistiques qui permettent à la poésie de s'insuffler. Morceaux pop étranges et fun cohabitent avec du classique pur : cela déroute, dérange, agace parfois, mais ne cesse jamais d'attirer la curiosité. La trame du récit, d'abord linéaire puis craquelée en saynètes dispersées comme un puzzle, est intéressante et audacieuse. Sorte de chewing-gum élastique et parfois franchement marrant où le temps s'étire dans des ralentis déroutants, La guerre est déclarée sent le bonheur à plein nez.. L'objet, cinématographique avant tout, parvient à dépasse la fonction de simple film : c'est un tableau de vie où les couleurs éclatent comme dans un tableau de Van Gogh, où le soleil tape, les feuilles tombent, le combat perpétuel des hommes, leur espoir, leur amour, fait perdurer l'envie de vivre, la seule qui combattra la mort. La mort et la vie, éternelles et curieuses oppositions : Donzelli le crie, le hurle : entres elles, c'est décidé ; la guerre, est déclarée.
Mise en scène : 4/5
Interprétation : 3/5
Travail artistique : 5/5
Scénarion : 4/5
Total des points : 16/20
Retour à l'index <----

Film d'action et d'horreur américain réalisé par Robert Rodriguez et co-réalisé par Quentin Tarantino sortit en 1996. 1h 50.

C'est deux types dans un désert. Lui, c'est le gangster normal, raisonné, qui n'aime pas tuer. L'autre, il est barge. Ils ont une mallette. Avec pleins de soussous dedans. Ils ont un rancard, dans un rade miteux, au Mexique. A la télé, une journaliste parle d'eux, parle de leur horreurs, avec un sourire masqué, une joie perverse. Là, on hésite à rire. Dans une autre scène, la toute première cette fois, tarantinesquement filmée, l'on voit le stéréotype du shérif désabusé, cinquante balais tout au plus, chapeau vissé sur la tête, entrant dans une boutique. Il chuchote, tranquillement. Raconte, au jeune vendeur, d'autres horreurs. L'histoire de quelques copains à lui à qui l'on a explosé le crâne. Il sur joue. Des mimiques improbables lui parcourent le visage. Impossible, cette fois, de ne pas rire. Mais on hésite encore...Très vite, au rythme des grains de sable qui filent au grès du vent, l'atmosphère nanardesque se fait vite, très vite sentir. Et puis, Tarantino arrive. Et on constate qu'on s'est trompé. Rodriguez se fout de nos gueules. L'écriture de son meilleur pote de cinéma, toujours tip top questions dialogues et répliques de comics biens senties, sent bon l'hommage aux vieilles séries B bien pourris qu'on aime bien, quand même. Et lorsque Clooney (excellent) demande à son frère de se coller une sorte d'appareil dentaire dans la bouche, et lui de lancer aux deux otages "parce que je grince des dents", on comprends qu'on à été roulé. On est bien dans un nanar. Mais un nanar qui assume. Nuance. Une fois tout les codes donnés : ça y’est, on peut rire. Se déroule alors une partie road-movie intéressante, pour les dialogues surtout. Au programme, violence, flingues pointés sur le front des invités, et des cactus à perte de vue, le tout dans la plus grande bonne humeur, assaisonné d'un délicieux seconde degrès correctement dosé. On aurait franchement tort de s'en priver. Mais lorsqu'on arrive au lieu du rancard, la partie sobre et, pourquoi pas, allons-y, carrément plausible, c'est fini. Comme si Rodriguez nous lançait : "Ca va ? Vous n’êtes pas fatigué ? On continue, alors ?!"...Soudainement, en un éclair, le cinéaste se met à parcourir l'alphabet, passe de la série B à la série Z, une transition réussie, inattendu finalemement, même si pas subtilement amenée non plus (faut pas déconner)... Pour les deux "héros", le nom du bar, déjà, ça sentait mauvais. "Tity Twister", en français : "Le téton tortillé". Devant les portes d'entrée, un type barbu en salopette introduit le lieu, et ça ne fait pas envie... Hurlant devant son micro, il présente ce qu'on peut y trouver, toute sorte de "chatte", de la meilleure à la pire qualité, soie, velours où polyester, et même une variété nouvelle : la chatte qui mord...Et profitez-en, jusqu'à la fin du mois, offre garanti : deux chattes pour le prix d'une...Et ça continue, comme ça, pendant plus d'une minute : mais quand/où s'arrêteront t-ils !?...Deuxième partie, donc, un tout autre style, mais respectant à merveille la loi de ces films là : forcément, à un moment où un autre, ça part en vrille. Et, yeahhh, qu'est ce que c'est bon !! Jouissif sur tout les points : du gore, d'autres répliques qui font mouche, des vampires qu'on-se-demande-ce-qui-foutent-là, feu d'artifice de flammes, fontaines d'hémoglobines, baston, re-baston, et tuerie complète pas crédible une seconde… Et Selma Hayek, dérouleuse de langues des mecs bien virils, python en guise d'écharpe. Scène culte. Film culte. Bourré d'imagination fertile coulant dans tout les plans comme gicle le sang. On croise, parmi toutes les trouvailles, l'hilarante guitare humaine (Pratique) et la croix fusil du seul pasteur du coin, rien de mieux pour dégommer les créatures repoussantes. Tarantino et Rodriguez s'amusent, et nous aussi. Ils se foutent de nous, un peu, et appliquent logiquement leur habituelle philosophie cinématographique : tout film respire le cinéma, n'importe lequel. Nanar où chef-d'oeuvre, qu'importe : n'est-ce pas la même chose, finalement ? Ils le prouvent avec cet excellent moment de détente, ce joyau du cinoche d'exploitation (ici d'ailleurs proprement détourné), où se laisser aller est la seule chose à faire. Et ce n'est sans doute pas la plus difficile.
Mise en scène : 4/5 (En totale immersion...)
Intérprétation : 5/5 (Tarantino, Clooney, Keitel et Lewis : Wahouu !!)
Travail artistique : 4/5 (Rade glauque admirablement reconstitué)
Scénario : 4/5 (C'est pour les dialogues, hein, vous inquiétez pas...)
Total des points : 17/20.
Retour à l'index <----

Comédie dramatique française réalisé par Michel Hazanavicus sortit en 2011. 1h40. Noir et blanc ; muet. Récomprenses notables : Cannes 2011 : Prix d'interpétation masculine (Jean Dujardin)

Un dimanche soir. Maudit changement d'heure : à peine le nombre 18 s'affichait-il sur les montres, il faisait déjà nuit. Pas un chat. La salle était sombre. Plongé dans l'obscurité. L'on entendait les fauteuils rouges qui grinçaient, parfois. Quelques rires se tortillant vers l'écran. Pendant de longues minutes, une musique un peu douce. Et, plus rien. Juste le bruit d'un verre posé sur une table. Un petit "TAC" annodin, insignifiant. Puis une sonnerie de téléphone. Puis des pas. Puis des rires narquois. Enfin, le cri déséspéré mais inaudible de George Valentin (Jean Dujardin), prisonnier dans son cauchemar d'un monde trop bruyant qui le laissera sur le bord de la route. Il y avait cette ambiance, cette émotion, palpable, évidente, baignant nos visages de spectateurs amoureux. Il y avait ce rayon de lumière noire, blanche, projetée sur la toile, effleurant le bout de nos crânes. Et il y avait le silence, aussi. Un beau et long silence. Il était tel, que l'on aurait même pu entendre les cris et la musique assourdissante du Tintin de Spielberg, dans la salle d'à côté. Où le rire incessant des spectateurs se régalant d'Intouchables, dnas la salle un peu plus loin... Un autre genre. Sans doute... Car le silence dominant était aussi magnifique, illustrant à merveille la beauté des images et la réalisation sublime d'Hazanavicius. Celui-ci, d'ailleurs, cinéaste mystérieusement attaché à ses vieilles bobines de grenier des années 20 (pour ce film-ci) à 60 (pour les OSS117), des babioles soit ringardes soit poussiéreuses et finalement si attachante, atteint, ici, l'aboutissement de son oeuvre. Un retour aux sources du cinéma, et pas des moindres. Pari risqué, financièrement insurmontable, et finalement ?... Réussite oui, chef-d'oeuvre, non. Le film eut-il été un peu moins sage, sans doute, dans son scénario charmant mais pataud, son histoire sympathique, universelle, mais finalement assez barbante ; cela aurait été parfait. Aurait-on voulu, même, l'oublier, cette histoire, une nouvelle fois. Celle des amours perdus et déviants qui se retrouvent à la fin, lors d'une scène, qui forcément (parce que l'amour c'est beau, c'est bien), nous fera vibrer... Sauf que là, étrangement, non. Et qu'aurait-il resté de tout cela, se dit-on, sans ces moments de poésie sublimes, où l'écriture devient visuelle, où la mise en scène touche à cette perfection technique et artistique incroyable ? La mise en scène, il faut en parler, elle est sublime, travaillée, intéressante. Elle donne à cet "Artist" ce relief et cette intensité grandiloquente propre au muet perdu dans son histoire. C'est bel et bien un exercice de style, un beau et bon travail, à voir sur grand écran, si possible. Tenant tout du long sur la corde raide entre poésie intimiste magnifique et divertissement familial ludique un peu moins interessant, c'est sa réalisation qui l'emporte. Dujardin aussi. Formidable, il fronce les sourcils, sourire en coins, mimiques milimétrées parfaites. Béjo illumine de sa grâce. Le film, amoureux, plein de passions, respirant le cinéma, emprunte aussi, à notre plus grand plaisir de cinéphiles satisfaits, ces grands films du patrimoine que sont Sunset Boulevard pour son idée de départ, et bien sûr Chantons sous la pluie, inoubliable...Et soudain, s'installe la nostalgie d'une époque retrouvée, et son écroulement. Les images défilent. S'y reflète surtout l'Amérique de ces années là, sa folie des grandeurs, ses lieux mémorables, son besoin de création. Avec pour seuls mots, quelques notes de musique et le "TAC" d'un verre posé sur une table...
Mise en scène : 5/5 (Avec bonus : prix du meilleur réalisateur aux Césars ne serait pas de refus...)
Interprétation : 4/5
Scénario : 2/5
Travail artistique : 4/5
Total des points : 15/20.
Retour à l'index <----
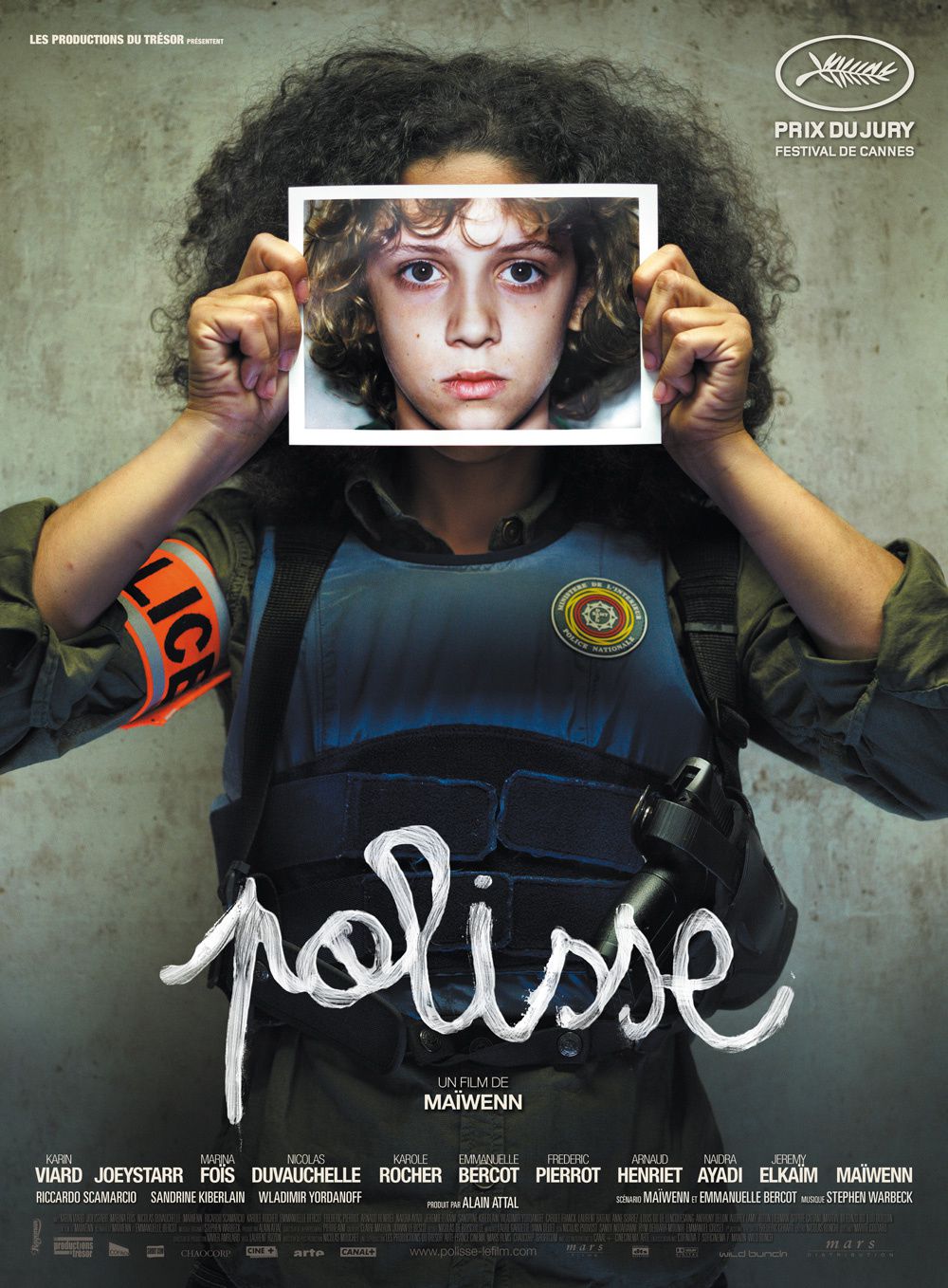
Film dramatique français réalisé par Maïwen sortit en 2011. 2h 10.Récompenses notables : Cannes : Prix du jury.

Une petite figurine pour gamins, dans une petite maison de poupées. Portes réduites, minuscules fenêtres. Et la chanson de Casimir, s'écoulant devant les images...Maïwen filme joliment l'enfance, quelques secondes. Et des prénoms d'acteurs s'inscrivant, chacun leur tour. "KARIN", "JOEY", "MARINA"...Tout de suite, l'on devine les liens, finement tissés, des acteurs de ce "Police avec deux S". Les personnages ne sont pas joués. Ils sont vécus, car ils existent, ils sont là, bel et bien là : ils souffrent, ils rient, ils sourient et ils pleurent, aussi. Souvent. Car Polisse respire la vie, l'amour, les sensations. Maïwen est le cinéaste de l'émotion. Celle-ci traverse, fulgurante, détruit, emerge dans tous les plans, toutes les scènes. Au début, une émotion. A la fin, une émotion. Chaque acteur, chaque figurant, la respire et en souffre. Et oui, ces flics ne sont pas des machines. Et parfois, ils s'en désolent. "Ca m'reste, ca m'tord...Je peux pas..." clame, hésitant et pudique, Joeystarr (Acteur bluffant, mauvais rappeur, qui devrait faire du cinéma son métier principal...). Une autre, entre deux interrogatoires avec deux pères pédophiles, quitte son mari, satisfaite, et plus tard, regrette. Un troisième hurle à sa copine bavarde qu'il ne parlera pas de sa journée. Terrible, faut-il bien dire. Celle si s'énerve. "Parce que tu crois que t'es le seul à sauver le monde ? Moi aussi à mon boulot j'ai des problèmes tout les jours !" Dit-elle... Et l'on apprend qu'elle travaille dans une crèche : belle ironie...Chacun de ses gens ont un point commun : ils travaillent ensemble, main dans la main, dans cette brigade peu connue qu'est la "BPM". On les voit, puis on SE voit, gens normaux et sympathiques. Ils parlent cul, politique, re-cul, re-politique, dans une cantine...Et boum, première rupture : soudain, la cinéaste les filme au boulot, ensemble, bavardant avec moult déséquilibrés, pédophiles inconscients, ados violées, mères junkies, et le reste de la gamme... En proposant un constat sec, brutal ; des scènes de vies importantes emboités dans un puzzle, avec rien qui se rattache forcément à un récit digne de ce nom, on peut se penser, au début, parti pour deux heures dix de documentaire. Il n'en est rien. En évitant toute forme de glauque, tout pathos, tout misérabilisme (il est même critiqué au milieu du film), Maïwen parvient à faire de son film un gigantesque chaudron bouillant d'humanité, criant de vie, bouleversant de rage, sombre et amer comme un citron frotté contre un morceau de charbon. Rit-on alors avec les protagonistes de toutes horreurs : l'humour, seul échappatoire valable contre les misères vues et vécues. Rit-on énormément, même, avec beaucoup d'amertume et de regret devant l'absurdité dramatique des situations. Ces instants de quotidien, les amours, les emmerdes, les rires et les joies, Maïwen les drape sous une épaisse couverture de nervosité glacée que l'on ne perçoit jamais, mais qui implose à la fin. Si Maïwen prend quelques rares fois plaisirs à nous mettre de façon si brutal en abime, elle aligne aussi gentiment tous les clichés du genre, pour faire plaisir aux rabats joies qui souhaiteraient la titiller, marque des personnages bien définis et très stéréotypés, mais s'en sert et leur creuse progressivement plusieurs fêlures. Le film en devient même pessimiste parfois. Les personnages se déséquilibrent suite aux horreurs inimaginables qu'ils ne se contentent pas d'entendre...Mais qu'ils affrontent chaque jour. Là est la nuance. Tant pis, alors, si quelques effets artificiels (L'histoire d'amour gnangnan entre Starr et sa cinéaste) viennent troubler la trouble beauté du film, justement. Tant pis alors si les enquêtes s'enchaînent dans un catalogue de situations faisant patiner un peu le tout, et que pour cela, le film aurait gagner à être bien moins long. Mais c'est à voir pour les acteurs, surtout. Foïs en tête, sa solitude incomprise, ses yeux bleus-gris humidifiés par les larmes et son visage fermé comme la pierre, Starr bluffant, criant d'émotion, et Viard, jamais autant meilleure. Et pour sa modestie, aussi. Parce que c'est clair : Maïwen ne semble pas vouloir faire de thèse sur le cinéma. Elle ne filme pas, elle capte, en transe, l’émotion et l'énergie. L'énergie qui s'estompe un peu, à la fin, dans un ralenti sublime où la virtuosité semble apaisée, le côté légèrement bordélique du long-métrage se stoppe soudainement, les plans sont cette fois triés, réfléchis...et la scène se termine, laissant un goût de cendre dans la gorge, quelques minutes après ce plan magnifique et tellement simple où des poussettes vides jonchent le trottoir, représentées comme les spectres étranges et immobiles des enfances volées. 16/20.
Mise en scène : 5/5
Interprétation : 5/5
Scénario : 4/5
Travail artistique : 2/5
Total des points : 16/20
Retour à l'index <----
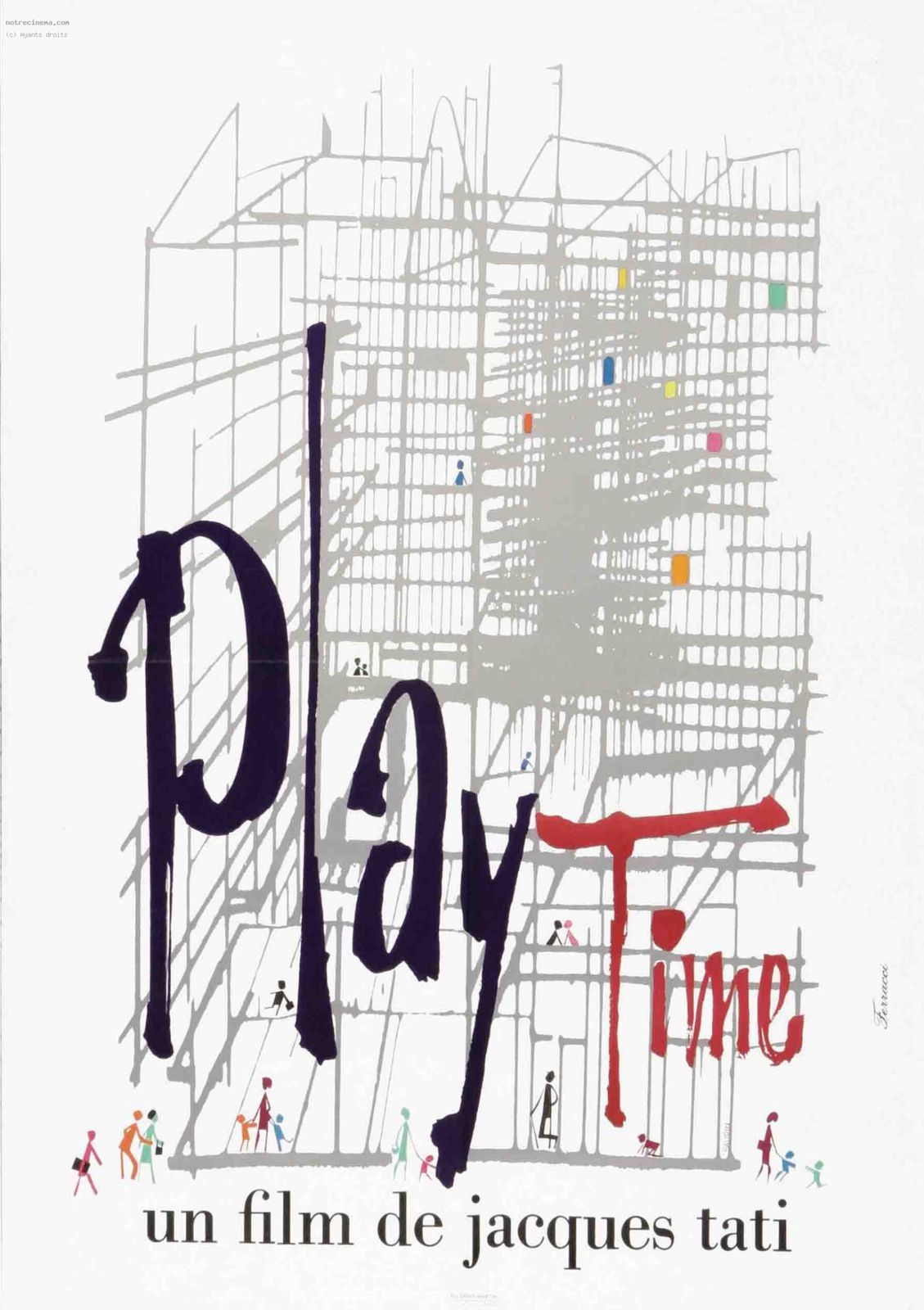
Comédie française réalisé par Jacques Tati sortit en 1937. 2h00.

Où est Hulot ? Où se cache t-il ? Dans quel petit coin de l'écran ? Derrière quel angle bétonné des immeubles impersonnels ? A l'intérieur de quel mouvement de foule de cette énorme jungle urbaine ? Le film commence par une vue sur un ciel bleu parsemé de nuages, et l'un des rares mouvements de caméra nous emmène devant un gratte-ciel d'un Paris futuriste, rétro, design, froid. Dans l'immeuble, une salle presque vide. A gauche, seul un couple d'âge mûr discute, d'une voix que l'on entend à peine. Des dialogues inaudibles, d'une importance minime, donc. Le sol est clair, brillant. Un homme passe, tourne, fait demi tour, puis encore une fois, tourne, avance, mouvements géométriques de ces pas et droit comme un "I", il semble attendre. Attendre quoi ? Qui ? On n'en saura rien. Il ne le dira pas. Il ne fera que ce taire, et marchera, toujours. Près de lui, un homme de ménage regarde par terre, lentement. Fixe ses pas. A-t-il fait des taches ? Le sol est-il aussi propre ? Eh bien oui. Tant pis. Une autre fois peut-être...Un brouhaha s'installe. La salle se remplit. Changement de plan. Les hommes, les femmes, les enfants, tous se placent dans le décor. Petit à petit, l'on découvre que nous sommes dans un aéroport. Le brouhaha continue, et l'on se met à chercher Hulot, nous spectateurs, parce que, arrêtons nos conneries, c'est quand même lui le héros...Est-ce lui là-bas, à gauche, de dos, plutôt grand, long manteau, chapeau en biais vissé sur la tête...Non...Peut-être lui, là-haut...Non plus...Tati installe un petit jeu de piste discret entre lui et nous, truffe chaque plans de gags visuels et sonores jamais appuyés, récompensant l'attention des plus attentifs. Hulot fini bien par apparaître, à un moment, et là...Un doux nuage s'empare de l'écran, celui sur lequel il flotte, en rêveur poli, observateur de la société, des gens, des mouvements. Une âme de cinéaste, donc, l'âme même de Tati qui dessine, dans cette satire féroce, le naufrage humain de la modernisation, l'uniformisation, le standard, l'impersonnel. Le personnage observe, assis sur un fauteuil improbable, un homme automate, chaque geste à la sonorité millimétrée, exagérée, absurde. Il fixe aussi, dans cette exposition inutile, le culte de l'objet roi. Il écoute, évasif, moult propositions : "Achetez la porte inaudible !!", "Ne manquez pas le nouveau balai électrique !". Il nous fait croire, quelques secondes, qu'il ne juge pas ces gens, affolés à l'idée de posséder les nouveaux appareils derniers cris. Et pourtant, plusieurs fois, c'est la poésie qui l'emporte. Tati truque les plans, creuse les plafonds, traverse les murs, les vitres, filme d'incessants jeux de miroirs, donne à son film, parfois, des airs de film muet...Playtime à toutes les qualités - et aussi les défauts - d'un film expérimental. Exit tout suspense, tout retournement, tout scénario qui se tient, mais pourtant, l'on ne s'ennuie jamais. Il y a assez de trouvailles, de travail graphique et sonore que l'on ne peut que s'incliner. Car Tati a recréé le monde. Et sans explicitement le dévoiler, le quotidien des hommes. Dans leurs dialogues inaudibles, se racontent les journées passées, le moment présent, l'avenir... Hulot n'est pas le héros. Il n'est qu'un autre monsieur, qui ressort d’abord à l'écran car en dehors, en marge de la folie absurde de l'univers dans lequel il vit. Rien de plus. Le vrai héros, en fait, c'est... personne. Et sans doute un peu tout le monde aussi. Tati nous le dit, cela, dans les deux dernières scènes du film. La première : un restaurant se rempli. Petit à petit. La musique commence. Là, tout bascule. Plus rien n'est symétrique. Ni les pas. Ni les mouvements. Ni les regards. On se déchaîne. On se parle, très vite. On danse ensemble. On retrouve des gens que l'on connaît. On retrouve des gens que l'on ne connaît pas. On les présente à d'autres, qui nous présentent à d'autres... Durant cette longue nuit, Hulot se montre clairement plus à l'aise. Il se prête au jeu, fait la rencontre d'une jeune touriste américaine (Barbara Denek). Jusqu'au petit matin. C'est la deuxième. Là, on se dit au revoir. On se quitte, pleins de regrets, prêts à se revoir, en fixant les ballons rouges, jaunes ou bleus qui se hissent sur les façades incolores des immeubles. Ce sont deux scènes magnifiques, où Tati quitte l'expérimental pour fixer, plein de tendresse et de bonheur, l'humanité, la vraie, se voyant renaître au coeur d'une magique nuit de fête.
Interprétation : 4/5
Mise en scène : 5/5
Scénario : 3/5
Travail artistique : 5/5
Total des points : 17/20
Retour à l'index <----

Documentaire américain réalisé par Keith Fulton et Louis Pepe sortit en 2003. Avec (Dans leur propre rôle) : Terry Gilliam, Johnny Depp, Jean Rochefort, Vanessa Paradis, et Jeff Bridges (Le narrateur). 1h 29.
:)

Synopsis : Lost in la mancha dévoile les coulisses d'un film inachevé, intitulé L'Homme qui tua Don Quichotte. Pendant plusieurs semaines, Keith Fulton et Louis Pepe ont suivi le réalisteur Terry Gilliam dans son combat désespéré pour sauver un projet qu'il développait depuis plus de dix ans.

Mon avis : Nous sommes probablement en Espagne, et au début. Au tout début. Il fait nuit noire, et, pendant que des bruits de fêtes courent de partout, des individus déguisés surviennent sur une place, torches embrasées à la main. Allures grotesques, ils commencent leur parade ; la cape tournoyante, tenant le feu presque entre leurs doigts. Des petits cris de foules. Des pas de danses, des galipettes. Tous sautillent dans tout les sens, enthousiastes, font la ronde, déjantés, insouciants...Sans doute moins que cet homme, assis en tailleur, caméra fixé à lil, filmant, visiblement inspiré, en tapant dans ses mains et souriant ; comme un enfant découvrant le monde...Car, tel que l'on nous le montre naïvement, Terry Gilliam est comme un enfant dans ce désastre inévitable. Impuissant. Sourire de hamster, contredit par un visage douloureux ; cette nuit festive où il fut encore plein de rêves et d'énergie. Dans le domaine des making-off, ce film bouleversant passe pour un chef-duvre. Il en n'a l'ambition, il en n'a l'émotion. Et l'histoire, surtout : "The Man Who Killed Don Quichotte", ce film inachevé, devenu peu après son annulation le fantasme officiel de bons nombres de cinéphiles. Aussi bouleversant soit-il, Lost in La Mancha reste jouissif jusqu'au bout. Il nous fait rire, passe par de petites crises de paniques à de grosses crises de nerfs, d'une péripétie cocasse à l'autre, d'une catastrophe naturelle à une catastrophe financière... Maladie de Rochefort (Très émouvant dans ce rôle de souffrant qu'il ne joue malheureusement pas), Coulée de boue torrentielle, problèmes financiers, budget restreints, absence de Vanessa Paradis, avion survolant le tournage, plateau semblable à un entrepôt...Et il y a l'équipe, l'équipe que l'on suit, cette équipe décomposée et dégoûtée ; et surtout, ce suspense. Ce suspense permanent, frustrant déboussolant..."Est-ce que Jean reviendra ?" "Allons-nous arrêter le tournage où continuer ?" Ce sont des questions comme cela, que se posent sans arrêt tout ce beau monde, tournant en rond, sans énergie et pourtant si agités...Certains se découragent, d'autres non, combatifs jusqu'au bout. Car se film n'est-il pas le symbole du perpétuel combat opposant les rêves contre la réalité ? L'immensité de ce qu'est l'industrie cinématographique Américaine contre celle qu'est l'Europe ? La simplicité contre la difficulté ? Les deux réalisateurs, par un hasardeux concours de circonstances, délivrent leur message : dans la vie, comme sur les tournages, tout n'est qu'enjeux, contrats, problèmes...Mais, comme Gilliam, il témoignent également de leur inconditionnel amour pour le septième art. Ils le prouvent sur la fin - aussi intelligente que le film tout entier -, où, en revanche, se greffe un bouleversant et même poétique soupçon de mélancolie. L'on voit alors un Terry Gilliam immensément déçu, tentant encore une fois de trahir sa déception par ses traditionnels sourires optimistes. L'on voit également, en gros plans sur un de ses dessins, son Don Quichotte idéal, longue moustache effilé et maigreur affolante, fuyant les moulins comme Gilliam la réalité ; et sa tête pleine de rêves (où se baladent les images insolites d'énormes pantins articulés et d'armures recyclées), bourrée d'extraits tous montés, tous tournés, de ce film qu'il écrit, qu'il conçut, qu'il vu, qu'il vécu, qu'il sentit, et enfin, par-dessus tout : qu'il espéra, en vain, oui, mais qui, a travers la force de ce superbe hymne au cinéma, prit vie de la plus belle manière. 17,5/20.

Drame franco-italien réalisé par Jean-Luc Godard sortit en 1963. Avec : Brigitte Bardot (Camille Javal) ; Michel Piccoli (Paul Javal) ; Jack Palance (Jeremy Prokosch) ; Fritz Lang (Lui-même). 1h 45 environ.

Synopsis : Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. Un incident apparemment anodin avec un producteur va conduire la jeune femme à mépriser profondément son mari.

Mon avis :
Dès le début, une caméra. S'avançant, suivant en travelling une femme qui marche. Puis, la voix de Godard lui-même, annonçant le générique. Et la citation d'André Bazin "le cinéma substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs". Rajoutant enfin "Le mépris est l'histoire de ce monde". Peu après, l'apparition de Fritz Lang, dans une salle où se déroule vraisemblablement une projection test. Des affiches de films. Des discutions. Une phrase de Louis Lumière inscrite sur un mur. Jack Palance, sarcastique, les yeux rivé sur un livre minuscule, bombé de citations. D'une certaine façon, la mise en scène sublime de Godard est une illustration de cinéma, plus particulièrement de ce fameux monde dont il est question. Parfois, pourtant, il semble préférer la prétention intellectuelle (citations, récitation...) aux émotions qu'il prétend faire passer. Justement, passons. Rien qui n'entrave la qualité étrange du film. Film culte, donc, en partie grâce à la beauté de Brigitte Bardot. Juste la beauté ? Oui. Soyons clair : elle est ridicule. Aussi ridicule que le casque de moto qui lui serre de perruque. Mais le cinéaste sait filmer son visage. Son corps. Il sait filmer à peu près tout, Godard. Surtout les sentiments. On raconte que sur le plateau, c'était un être silencieux. Car le silence, chez lui, ne pèse pas. Mais triomphe, révèle. Ici, l'écroulement des sentiments et le mépris qui se dessine peu à peu. Et laisse donc la place aux gestes : BB laissant tomber une pile d'assiette. Piccoli donnant une tape sur les fesses d'une jeune femme. Le bruit de cette tape. La mer, les arbres, le vent de Capri. Et puis, le silence. Ça ressemble à un film expérimental, étrange et fascinant, voir même poétique, aux décors un peu kitsch et aux couleurs clinquantes. C'est à la fois un hommage au cinéma (La sagesse de Fritz Lang) qu'une utilisation de ce même art : un couple se défait, un film se fait. C'est une uvre résolument simple, finalement. Simple comme serait le monde idéal selon le cinéaste : un monde où rien ne serait à expliquer. Mais à comprendre sans se casser la tête. Où la vérité de ce que ressentent les êtres serait à chercher et trouver dans leurs visages, leurs gestes ; comme le personnage de Piccoli se rendant compte après réflexion que sa femme le méprise. Exigeant pourtant des explications. Mais Godard disait que "dans le cinéma comme dans la vie, il n'y a rien de secret, rien à élucider, il n'y a qu'à vivre et à filmer". Tout tient à cela. Au cinéma. Aux visages. Aux gestes. Et au silence... 15/20.


Policier, Drame et Thriller américain réalisé par Martin Scorsese sortit en 2006. Avec : Leonardo DiCaprio (Billy Costigan) ; Matt Damon (Colin Sullivan) ; Jack Nicholson (Franck Costello) ; Mark Wahlberg (Dignam).
Oscar 2007 du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté, du meilleur montage.

Synopsis : À Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise.
Pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la police infiltre son gang avec "un bleu" issu des bas quartiers, Billy Costigan.
Tandis que Billy s'efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sullivan entre dans la police au sein de l'Unité des Enquêtes Spéciales, chargée d'éliminer Costello. Mais Colin fonctionne en "sous-marin" et informe Costello des opérations qui se trament contre lui.
Risquant à tout moment d'être démasqués, Billy et Colin sont contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leurs repères et leur identité.

Traquenards et contre-offensives s'enchaînent jusqu'au jour où chaque camp réalise qu'il héberge une taupe. Une course contre la montre s'engage entre les deux hommes avec un seul objectif : découvrir l'identité de l'autre sous peine d'y laisser sa peau...

Mon avis :
Martin Scorsese sait jouer au spectaculaire, évidemment. Il y a des scènes d'action haletantes, superbement orchestrées. Le suspens est insoutenable. On se lève de son fauteuil, on tremble, on frissonne, et tout et tout...Mais le cinéaste n'est jamais aussi bon que lorsque qu'il filme une société, une CERTAINE société, doublée du monde tel qu'on la fait, grouillant de ces "rats" que Nicholson, délirant en parrain vieillissant, déteste. Ces rats, ces hommes, donc, se sautant à la gorge à chaque occasion et s'entretuant en autre temps. Ces rongeurs vicieux, profitant de leur puissance pour appâter les vulnérables et ne faire que les berner, les trahir et les humilier. Criminels comme flics, une bonne partie sont véreux et deviennent finalement impuissant. Faits...comme des rats. Sur le sujet du pourrissement de la société, Orson Welles en avait aussi touché deux trois mots. C'était à la fin des années 50, si je ne m'abuse, avec La soif du mal. Pas le film similaire le plus évident, mais pourvu de quelques idées comparables. Surtout chez le personnage du policier corrompu incarné par le même cinéaste. Inspiré déjà par ce film et aussi par le chinois Infernal Affairs (dont il fait le remake), Martin Scorsese, virtuose de la mise en scène, offre une uvre d'une richesse rare, et marie superbement les genres. Du film noir Shakespearien au suspens à grand spectacle, pour le cinéaste, il n'y a quun pas. "Qu'on soit flic où criminel, devant un flingue : Quelle différence ?" Est la grande question du film. La réponse étant quil ny en a aucune, le but de Scorsese sentêtant à le prouver : il manie donc la caméra comme un flingue, pointée sur les personnages. Il traque presque cruellement leurs peurs intimes, leurs craintes. DiCaprio (excellent) devient dérangé, Damon (troublant), dépassé...Tous serrant les dents pour ne pas être découverts, tremblant de la main où l'arme est placé...Distinguant les regard et les gestes des autres pour traquer la vérité, l'un suivant l'autre, l'autre suivant l'un...Tout les deux comme sur un fil, entre deux gratte-ciels, au-dessus des hommes qui paraissent bien petits...A tout moment, l'un, comme l'autre, risque de tomber. A tout moment l'un, comme l'autre, risque de tirer. Il y a dans les visages de ces hommes déchirés et craintifs, à l'affût des gestes de l'autre, une dimension tragique. Scorsese, dans le développement de la psychologie de ses antihéros (Il en envoie même un chez une psy !), fait presque du Kubrick. Que de références, me diriez-vous...Et quelles références ! Pourtant, le réalisateur ne se contente pas de copier ses maîtres : ses "Infiltrés" innove, bouscule les codes, s'imposant et se démarquant, jubilatoire et cruel. 18/20.

Du même réalisateur sur "Ptit'ciné, le blog" :

Genre : Petit blog avec prétention
Création : Août 2010
Sujet : Culture, Cinéma
Fondateur : Le plus beau, le plus intelligent, le plus pertinent, le plus cinéphile, le plus au-dessus de la basse populace...Ptit Ciné !
Films favoris :
1. The Truman Show (Peter Weir)
2. Barry Lyndon (Stanley Kubrick)
3. Batman, le défi (Tim Burton)
4. Les enfants du paradis (Marcel Carné)
5. Boulevard du crépuscule (Billy Wilder)
6. Metropolis (Fritz Lang)
7. La Nuit du Chasseur (Charles Laughton)
8. Holy Motors (Leos Carax)
9. Ed Wood (Tim Burton)
10. Eve (Joseph L. Manckiewicz)
11. Reservoir Doggs (Quentin Tarantino)
12. Magnolia (P.T. Anderson)
13. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry)
14. Kill Bill Volume II (Quentin Tarantino)
15. M le Maudit (Fritz Lang)
16. Cris et chuchotements (Ingmar Bergman)
17. Fenêtre sur cours (Alfred Hitchcock)
18. Shining (Stanley Kubrick)
19. Elephant Man (David Lynch)
20. Toy Story 3 (Lee Unkrich)