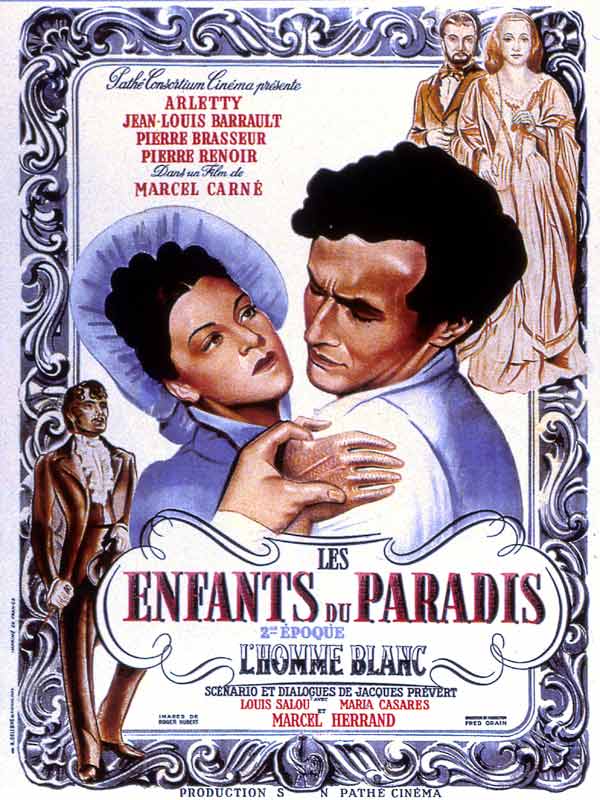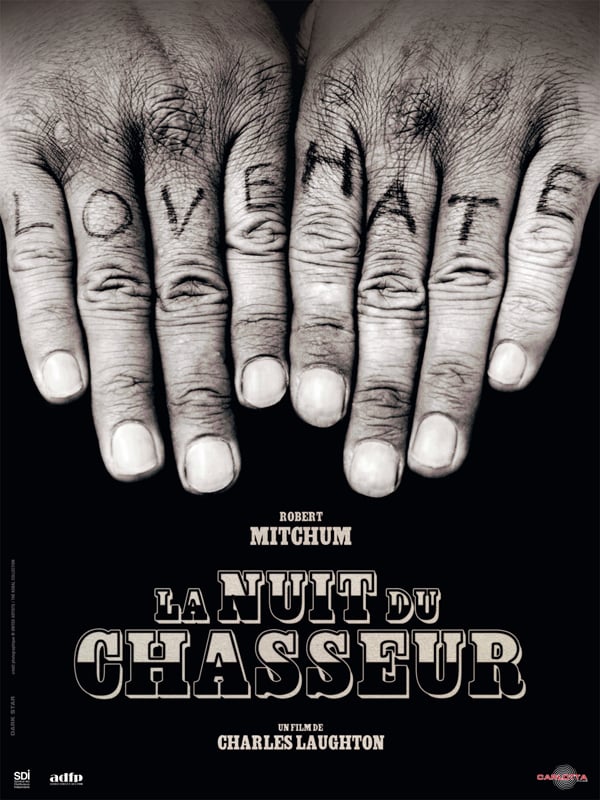Policier, Drame et Thriller américain réalisé par Martin Scorsese sortit en 2006. Avec : Leonardo DiCaprio (Billy Costigan) ; Matt Damon (Colin Sullivan) ; Jack Nicholson (Franck Costello) ; Mark Wahlberg (Dignam).
Oscar 2007 du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté, du meilleur montage.

Synopsis : À Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise.
Pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la police infiltre son gang avec "un bleu" issu des bas quartiers, Billy Costigan.
Tandis que Billy s'efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sullivan entre dans la police au sein de l'Unité des Enquêtes Spéciales, chargée d'éliminer Costello. Mais Colin fonctionne en "sous-marin" et informe Costello des opérations qui se trament contre lui.
Risquant à tout moment d'être démasqués, Billy et Colin sont contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leurs repères et leur identité.

Traquenards et contre-offensives s'enchaînent jusqu'au jour où chaque camp réalise qu'il héberge une taupe. Une course contre la montre s'engage entre les deux hommes avec un seul objectif : découvrir l'identité de l'autre sous peine d'y laisser sa peau...

Mon avis :
Martin Scorsese sait jouer au spectaculaire, évidemment. Il y a des scènes d'action haletantes, superbement orchestrées. Le suspens est insoutenable. On se lève de son fauteuil, on tremble, on frissonne, et tout et tout...Mais le cinéaste n'est jamais aussi bon que lorsque qu'il filme une société, une CERTAINE société, doublée du monde tel qu'on la fait, grouillant de ces "rats" que Nicholson, délirant en parrain vieillissant, déteste. Ces rats, ces hommes, donc, se sautant à la gorge à chaque occasion et s'entretuant en autre temps. Ces rongeurs vicieux, profitant de leur puissance pour appâter les vulnérables et ne faire que les berner, les trahir et les humilier. Criminels comme flics, une bonne partie sont véreux et deviennent finalement impuissant. Faits...comme des rats. Sur le sujet du pourrissement de la société, Orson Welles en avait aussi touché deux trois mots. C'était à la fin des années 50, si je ne m'abuse, avec La soif du mal. Pas le film similaire le plus évident, mais pourvu de quelques idées comparables. Surtout chez le personnage du policier corrompu incarné par le même cinéaste. Inspiré déjà par ce film et aussi par le chinois Infernal Affairs (dont il fait le remake), Martin Scorsese, virtuose de la mise en scène, offre une uvre d'une richesse rare, et marie superbement les genres. Du film noir Shakespearien au suspens à grand spectacle, pour le cinéaste, il n'y a quun pas. "Qu'on soit flic où criminel, devant un flingue : Quelle différence ?" Est la grande question du film. La réponse étant quil ny en a aucune, le but de Scorsese sentêtant à le prouver : il manie donc la caméra comme un flingue, pointée sur les personnages. Il traque presque cruellement leurs peurs intimes, leurs craintes. DiCaprio (excellent) devient dérangé, Damon (troublant), dépassé...Tous serrant les dents pour ne pas être découverts, tremblant de la main où l'arme est placé...Distinguant les regard et les gestes des autres pour traquer la vérité, l'un suivant l'autre, l'autre suivant l'un...Tout les deux comme sur un fil, entre deux gratte-ciels, au-dessus des hommes qui paraissent bien petits...A tout moment, l'un, comme l'autre, risque de tomber. A tout moment l'un, comme l'autre, risque de tirer. Il y a dans les visages de ces hommes déchirés et craintifs, à l'affût des gestes de l'autre, une dimension tragique. Scorsese, dans le développement de la psychologie de ses antihéros (Il en envoie même un chez une psy !), fait presque du Kubrick. Que de références, me diriez-vous...Et quelles références ! Pourtant, le réalisateur ne se contente pas de copier ses maîtres : ses "Infiltrés" innove, bouscule les codes, s'imposant et se démarquant, jubilatoire et cruel. 18/20.

Du même réalisateur sur "Ptit'ciné, le blog" :